L’homme déraciné
L’homme s’est peu à peu coupé de la nature. Dans un premier temps, pour s’en protéger, afin de se prémunir des dangers primaires qu’elle recèle, en se réfugiant derrière les remparts des premières villes, et peu à peu dans le confort lénifiant de la vie moderne où la possession de murs et la consommation d’objets sont devenues la véritable religion contemporaine. Dans le même temps que ce retranchement dans l’espace urbain, les hommes sont partis à la conquête systématique du monde sauvage pour le domestiquer, l’exploiter à outrance et le mettre sous sa coupe réglée et industrialisée.
Dans un second temps, la nature a été soigneusement expurgée de l’espace urbain par la prolifération d’un maillage infini de rues et d’immeubles, créant un univers oppressant de rivières bitumées, sorte de rubans asphaltés rigoureusement ordonnancés par une multitude de panneaux-indicateurs, censés régler la circulation et rappeler toutes les interdictions qui caractérisent les sociétés humaines (sens uniques, sens interdit, interdiction de stationner, de dépasser, limitation de vitesse, voies réservées…). Dans ces paysages horizontaux et soigneusement codifiés, la verticalité des arbres déracinés a été remplacée en un mouvement d’urbanisation galopante, par la prolifération du béton et de l’acier, faisant disparaître l’horizon et l’immensité du ciel.
Dans cet univers contrôlé et plus ou moins harmonisé, l’artificiel a remplacé le naturel, le régulé a fait disparaître le spontané et l’homme n’a toléré à titre ornemental que quelques « espaces verts » au milieu de cette océan de grisaille, qu’est devenu « l’espace urbain ».
Dans une sorte d’inconscience collective, les hommes ont consenti à leur propre emprisonnement, dont la principale manifestation est la disparition de leur liberté et leur enfermement généralisé. De l’aube jusqu’au soir, l’humanité citadine passe dans une succession infinie de lieux d’enfermement. Le matin, l’homo Erectus quitte son appartement, dans lequel il vient de passer 8 heures, derrière la protection d’une solide porte blindée et de verrous trois-points, pour se prémunir d’une insécurité colportée à longueur d’écrans par des chaines d’info en continu ou dégoulinant du robinet à mauvaises nouvelles et fantasmes-à-assouvir que sont les réseaux sociaux. Il descend dans la boîte d’un ascenseur ou par la cage d’un escalier pour rejoindre le métro souterrain le plus proche, devenu une forme moderne de bétaillère déshumanisée, où s’entasse un peuple fantôme, enchainé à un portable, ou bien pour s’enfermer dans sa voiture bourrée de capteurs, d’alarmes, et d’outils de contrôle automatisé.
Sur ce point, l’autonomie d’un véhicule, qui était autrefois sa capacité à emmener ses passagers le plus loin possible sans refaire le plein, est désormais définie par l’ensemble des dispositifs électroniques qui régissent la conduite et affranchissent le conducteur de toute décision, sous le prétexte de le libérer ou d’assurer sa sécurité, en confiant – bon gré, mal gré – à la fée technologique, sa survie et celle de ses éventuels passagers. Cette tendance inéluctable, au-delà des vicissitudes qu’elle connait, va devenir la norme et réduire la liberté de tout conducteur, notamment de celui qui jouissait du plaisir de la conduite, et le renvoyer à des tâches jugées plus nobles (comme le divertissement, l’habitacle devenant un salon multimédia) ou plus productives (l’espace intérieur se transformant en bureau roulant). Au fur et à mesure que la voiture deviendra autonome, l’usager perdra sa propre autonomie et, par la même occasion, sa capacité d’agir par lui-même sur les choses et les évènements. Sous prétexte d’être assisté, il se verra dépossédé, par la réglementation et le progrès technique, de sa liberté de décider et de jouir de ce qui lui plait.
Mais revenons un instant au gymkhana urbain qui nous est imposé par la civilisation contemporaine. Parvenus à destination, ceux d’entre nous qui sont salariés d’une boîte, la rejoindront pour 8 heures de labeur, vissés à un bureau sur lequel ils auront le loisir d’inviter la nature, sous la forme d’une plante verte ou d’un mini cactus produit pour cet usage, afin d’entretenir leurs rêves d’exotisme ou de complaire à la facilité d’entretien de cette espèce végétale qui, à l’image de leur vie, ne manque pas de piquant. S’ils travaillent en open space (qui est tout sauf la traduction du grand air), ils se verront sans doute attribuer un cubicle, qui n’est autre qu’une mise anticipée entre quatre planches, sur lesquelles ils auront le loisir de punaiser quelques photos personnelles et des cartes postales de vacances lointaines, pour pouvoir s’échapper à loisir ou se remémorer qu’ils ont une vie, en dehors de leurs heures d’enfermement. Une partie des cadres de ces entreprises, qui règnent sur un emploi du temps et une escouade de salariés déboussolés, passeront le plus clair de leur temps enfermés dans des salles de réunion, à palabrer de choses qui les tiennent soigneusement éloignées des grands problèmes du monde et des considérations importantes de leur propre existence.
L’autre partie de la foule matinale ira s’enfermer à son tour dans des écoles, des usines, des hôpitaux, des administrations, des magasins, d’autres formes de boîtes ou de lieux clos, afin d’y dépenser leurs journées et de gagner de quoi assumer leur mode de vie, dont plus de la moitié servira à financer la boîte dans laquelle ils se logent (appartement ou maison individuelle) ainsi que les dépenses concomitantes (assurances, carburant, chauffage, charges, entretiens, taxes diverses).
Dans ce monde où l’essentiel de la population vit claquemurée durant toute la journée et finit par rentrer à la nuit tombée, complètement claquée, entre les quatre murs de la cellule familiale, rares sont ceux qui passent leurs heures en plein air. On croise en pleine journée, les ouvriers du bâtiment et des travaux forcés qui construisent ou rénovent les immeubles et les tours de futurs emprisonnés. On croise aussi, toute une myriade de personnes âgées qui ne savent pas quoi faire de leur temps libre et déambulent à pas de sénateur, avec la mine souvent fermée et leur souvenirs battant en retraite, le long des trottoirs livrés aux marchands du temple. Enfin, les autres passants que l’on croise aussi sont quelques évadés momentanés, fatalement en transit entre deux lieux d’enfermement, des femmes au foyer qui vaquent à leurs obligations ou butinent les étalages de boutiques quand d’autres se contentent de lécher les vitrines. On croise aussi quelques mères de familles précédées d’une poussette dernier cri, dans laquelle siège un bambin qui balade sa candeur juvénile au milieu de ce parc urbain, grandeur nature, constellé de passages cloutés, de feux tricolores, de mobilier urbain et de merchandising. Au milieu de cet univers au paroxysme de l’artificiel, il faut voir l’enthousiasme et le rire qui illuminent le visage insouciant des enfants, ces deux symboles d’innocence disparus, depuis belle lurette, du visage inexpressifs des adultes, accaparés par leurs pensées ou échafaudant secrètement des plans d’évasion vers une vie meilleure.
Lorsque l’heure de la récréation de fin de journée sonne enfin, les masses laborieuses ou affairées se scinderont et rejoindront les tunnels du métro ou la bulle de transit d’un bus ou d’une automobile. Certains rentreront directement chez eux, quand d’autres se hâteront d’aller s’enfermer à nouveau dans des supermarchés, forme moderne et subtile de la chasse au mammouth, ou dans une salle de sport afin de s’entretenir, soucieux de leur forme autant que de leur aspect, ou pour se dépenser enfin et se défaire des affres de leur vie sédentaire.
D’autres iront rejoindre des potes pour prendre un pot et papoter au fond de bistrots ou de restaurants, afin de comparer leurs accaparantes journées, de se plaindre de leur patron et d’évoquer leurs rêves d’escapade ou quelques projets pour remplir leur temps libre. Une partie de la horde urbaine s’engouffrera dans des cinémas, des salles de concert ou de spectacle pour s’évader durant quelques heures et satisfaire leur besoin d’altérité ou d’émotion. Les plus vaillants finiront leur soirée en boîte, une fois la semaine achevée. L’alcool et le son à gogo leur faisant oublier l’essentiel de cette existence carcérale, loin de la nature et de la vraie liberté.
Mais l’essentiel de la population finira ses soirées devant le petit écran, celui de la télé qui donne des visions, ou absorbé individuellement par l’écran minuscule d’un smartphone, qui l’inondera d’un point de vue sur le monde conforme à ses attentes, ou flattant ses plus bas instincts, entretenant savamment sa peur ou ses névroses, par l’intermédiaire du petit bout de la lorgnette d’un algorithme, dopé à l’intelligence artificielle.
Alors pourra disparaître une nouvelle fois, pour 8 heures de repos bien méritées, le peuple ensommeillé des « Homo ça pionce ! ». La nuit accueillera les doux songes des citadins malmenés par une existence cadencée et imposée par un système fondé sur la norme, la frustration et le renoncement à une vie simple, sobre et heureuse. La nuit deviendra l’espace libre et propice à tous les possibles, à l’envol des lendemains qui chantent, à la concrétisation des projets inavouables, à ceux plus raisonnables mais sans cesse reportés aux Calendes grecques, aux espoirs de gains libérateurs à la Loterie Nationale, au remboursement anticipés des crédits à la consommation, à des rencontres amoureuses magnifiquement inspirantes, à des guérisons miracles qui débouchent sur une santé de fer et le courage de faire, à tous ses rêves que l’on porte légitimement en soi mais patientent secrètement dans nos vies au compte-goutte.
Face à l’artificialisation de son existence et à la bétonisation de son cadre de vie, le citadin semble se satisfaire d’un verdissement de l’espace public et de la création de voies cyclables qui lui permettront à loisir de se déplacer en quelques tours de pédales, par ce moyen économe, remis au goût du jour et pratique pour échapper à son confinement volontaire.
Mais le vrai problème de notre époque et sans doute la source de bien des maux est la désagrégation des rapports humains, la rupture du lien social ou en d’autres termes, l’incapacité grandissante de vivre ensemble, œuvrant collectivement au développement d’une société harmonieuse, tolérante et solidaire.
On pourrait dresser une liste infinie de problèmes divers, de raisons collectives ou de comportements individuels qui participent à la dégradation de nos sociétés modernes, notamment dans les grandes métropoles, sortes de bouillons de cultures où les effets se font plus durement ressentir qu’ailleurs. Mais jamais auparavant, les hommes n’ont été aussi connectés les uns aux autres et les relations entre eux si indigentes, leur antagonismes aussi exacerbés. Jamais l’homme n’a été confronté à une telle balkanisation des communautés, à un tel replis sur soi et ses propres certitudes, et à une telle animosité sur tout ce qui ne lui ressemble pas. Et pourtant, plus que jamais dans ce monde désormais globalisé, d’une complexité infinie, la prise en compte de l’Autre, dans ses différences, dans sa richesse culturelle et dans son point de vue singulier, n’aura été aussi cruciale et précieuse afin d’affronter les enjeux immenses qui s’imposent à nous et pour œuvrer tous ensemble à trouver les meilleures solutions à l’échelle de la planète.
Pour conclure sur ce sujet, je laisserai la place à la Poésie, qui montre toujours le chemin le plus juste, lorsque l’avenir s’obscurcit et que nos jours se perdent dans la brume de l’incertitude.
Qui mieux que Christian Bobin pour tracer le cap vers l’essentiel, comme un rappel lancé à l’attention de notre humanité déboussolée ou en guise de testament, constituant une magnifique feuille de route pour chacun d’entre nous ?
« La rencontre est le but et le sens d’une vie humaine.
Elle permet qu’on ne la traverse pas en somnambule.
Quand mes yeux se fermeront, ils le feront sur une immense bibliothèque constituée par des visages qui m’auront ému, troublé, éclairé.
Un visage est éclairant quand un être est bienveillant et qu’il est tourné vers autre chose que lui-même.
Le soin qu’il prend de l’autre, l’illumine, le rend vivant.
Il capte une lumière et la renvoie.
C’est quelque chose de rare.
La richesse de cette vie est faite surtout de visages et de quelques paroles. »



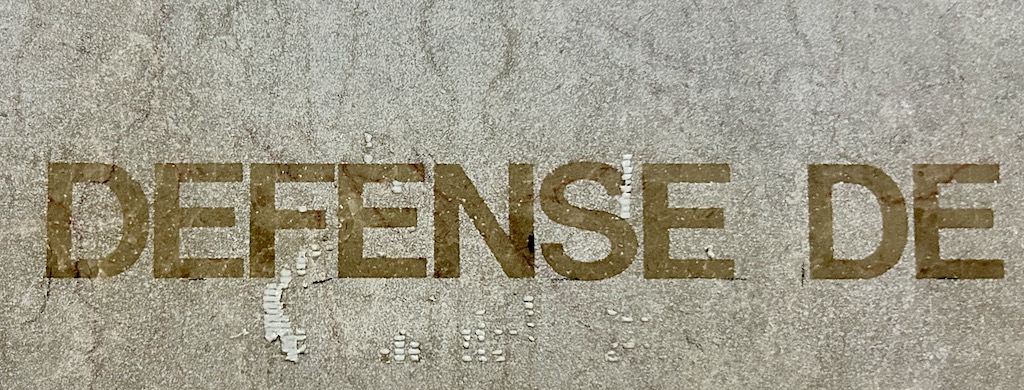

formidable chronique;-)
J’aimeAimé par 1 personne